





















|

Le Sentiment Cosmique

Jean-Pierre Luminet
Astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon
& poète.
Les poètes et l'univers,
aux Éd. Descartes et Cie, Paris, 1996
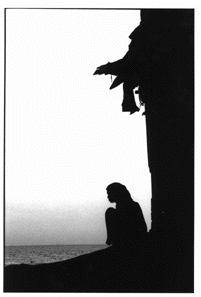 L'un des thèmes les plus puissants de la poésie est celui qui traite de la relation entre l'homme et le cosmos. " On se penche jusqu'à tomber sur l'astro- et la microphysique, mais qui aidera l'homme à vivre debout, à garder sa station verticale entre ces deux extrêmes ? ". Cette formule de Daniel Pons1 résume au mieux l'interrogation -- millénaire car fondamentale -- sur la place de l'homme dans l'univers.
L'un des thèmes les plus puissants de la poésie est celui qui traite de la relation entre l'homme et le cosmos. " On se penche jusqu'à tomber sur l'astro- et la microphysique, mais qui aidera l'homme à vivre debout, à garder sa station verticale entre ces deux extrêmes ? ". Cette formule de Daniel Pons1 résume au mieux l'interrogation -- millénaire car fondamentale -- sur la place de l'homme dans l'univers.
Le cosmos peut être considéré comme le type même de toute construction mentale. À ce titre, il est la pierre de touche de l'imagination créatrice. En présence de ce qu'il y a de plus vaste et de plus subtil, de plus étranger et de plus intime à la fois -- l'Univers -- les imaginations se séparent et se groupent spontanément en deux familles, deux tempéraments pratiquement irréconciables. Ce sont les deux " sentiments du monde " -- Parménide contre Héraclite -- qui coexistent au cours de l'histoire, quels que soient les développements de la science astronomique -- même si ces derniers semblent à première vue favoriser, à telle ou telle époque, telle ou telle vue du monde.
Chez les uns -- les descendants de Parménide -- règne l'Harmonie du Monde, et l'homme trouve naturellement sa place dans cette belle construction. Cette place a, certes, varié au cours des âges. Initialement centrale à tous égards (l'homme au sommet de la création divine sur une Terre au centre du monde), elle s'est décalée sous la poussée des découvertes scientifiques. Avec Copernic, Newton et leurs successeurs, la Terre est devenue une simple planète tournant autour d'une étoile banale, elle-même gravitant dans une galaxie banale parmi des milliards d'autres galaxies. Avec Darwin et les théories de l'évolution, l'espèce humaine n'apparaît plus comme le sommet de la création, mais comme l'extrêmité provisoire d'un rameau chanceux sur l'arbre de la vie. Mais quels que soient les bouleversements de l'image du monde, pour ces esprits-là l'idée d'Harmonie entre l'homme et l'Univers ne peut finir. Ils livrent une lutte infatigable pour retrouver cet ordre exigé par les lois qui régissent leur propre fonctionnement mental, à eux, fils du Cosmos, et qui ne peuvent s'y croire étrangers.
Chez les autres s'impose un Univers aveugle et absurde, où, si un ordre relatif s'établit parfois et de façon purement mécanique, le désordre reste la loi. Cette vue, qui se rattache au tempérament "héraclitéen", a pour fondement l'atomisme antique. Dans ce schéma, l'Harmonie du Monde est pure construction de l'esprit. " L'entendement humain incline naturellement à supposer l'existence de plus d'ordre et de régularité dans le monde qu'il n'en trouve. Et quoiqu'il y ait dans la nature beaucoup de choses singulières et sans symétrie, il leur trouve des parallèles et des relations qui n'existent pas. De là la fiction que tous les corps célestes se meuvent en cercles parfaits", écrit Francis Bacon, l'un des premiers représentants de la science du XVIIe siècle. Dans un univers absurde, l'homme vit mal; évacué de la scène cosmique, il n'a nulle place, sinon, au mieux, celle d'une brève floraison sans lendemain, au pire celle d'une vermine. Les poètes de cette famille, attirés ni par la perfection des sphères célestes ni par les vertiges de l'infini, sont les chantres de la misérable condition humaine, broyée par une immensité cosmique indifférente.
Une position aussi pessimiste est toutefois restée marginale dans l'antiquité grecque et dans le Moyen Âge chrétien -- reflet de la position marginale de l'atomisme face à l'idéologie aristotélicienne dominante. C'est dans d'autres cultures qu'il faut chercher, à ces époques, des poètes de première grandeur nous prévenant que l'homme n'est que poussière. C'est le cas des humanistes persans Omar Khayyam (XIe siècle) et Djala-l al-Din Ru-mi- (XIIIe siècle). Dans leurs Quatrains Ruba-`iyya-t2 ils ont raillé la prétention des hommes à vouloir déchiffrer l'énigme du ciel. Chacune de leurs strophes sur la petitesse de la condition humaine est d'une immense envergure. L'homme n'est vraiment qu'un pion sans importance sur l'échiquier cosmique ; d'où venons-nous ? où allons-nous ? sont de vaines questions. Plaisirs terrestres pour l'un, méditation mystique pour l'autre, peuvent seuls nous faire oublier l'absence de réponse.
Revenons à la Renaissance en Occident, période de transition où coexistent traditions et gestations. Jacques Peletier du Mans a toute sa vie rêvé de réussir la synthèse poétique des sciences et des lettres ; pour lui, la poésie scientifique est un exercice d'hygiène, nécessaire à l'entretien de la pensée. L'amour des amours (1555) est le texte fondateur de la haute poésie scientifique du XVIe siècle. Il parachève par des chants célestes un ensemble de poèmes amoureux qu'il avait naguère dédiés à la gloire d'une créature terrestre. Influencé par Cicéron (Le songe de Scipion) et Dante, il imagine un voyage à travers le ciel sublunaire. Sa Dame, qui le guide, lui révèle les secrets de l'amour céleste. Peletier soutient que la contemplation savante du ciel est capable de procurer une extase religieuse, et par ce ravissement, l'âme atteint le dieu pur des mystiques intellectuels.
Tommaso Campanella développe une conception similaire. Ce dominicain, auteur du célèbre dialogue poétique la Cité du Soleil, dut subir à partir de 1599 un double procès, pour sédition politique et hérésie. Condamné à perpétuité, il fut libéré en 1629. Son oeuvre poétique, brève, fut composée au cours de ses vingt-sept années de captivité. Dans "Âme immortelle, il nous dit que le savoir est saveur ; il faut goûter aux choses, avoir un contact immédiat avec elles, pour accéder à la connaissance. Dans "Du monde et de ses parties, il ravive la métaphore traditionnelle du monde vu comme un "grand animal, en comparant l'homme avec les vers et les poux -- comparaison reprise peu après par Pascal qui, dans un texte célèbre, prend l'exemple du ciron pour traduire l'effroyable petitesse de l'homme au regard des "espaces infinis.
L'écrivain anglais Alexander Pope publie en 1734 "Essai sur l'Homme, poème philosophique dont la première partie s'intitule "l'homme par rapport à l'univers. Pope veut montrer comment le Bien domine le Mal et régente l'univers. Proclamant que la bonté et la dignité sont les qualités naturelles de l'homme, il ne partage nullement les vertiges angoissés de Pascal.
Entre angoisse et extase, "La plus haute pensée humaine est l'un des plus beaux textes de Jean-Paul Richter, extrait de son roman autobiographique Hespérus (1795). L'idylle amoureuse entre le héros et Clotilde se dénoue en une apothéose cosmique, en présence d'Emmanuel, un philosophe adonné aux disciplines orientales, qui les initie au sentiment cosmique. Ce n'est pas l'homme qui se plonge dans la nature pour s'y perdre, mais la nature qui lui fait escorte, soulignant les moindres mouvements de son âme. Jean-Paul y manifeste une sensibilité devant la nature, propre au romantisme naissant. Romantisme cosmique déjà affirmé, et totale identification avec la nature chez Walt Whitman (Cosmos, 1855). En digne habitant du Nouveau Monde, ce grand poète du sentiment cosmique s'approprie aisément les nouveaux horizons.
L'essence même du Romantisme, nul ne peut mieux en juger que Charles Baudelaire. Ce n'est point par hasard si celui-ci a magnifiquement traduit ce modèle de la rêverie scientifique qu'est l'Eureka d'Edgar Poe. "Malgré Newton et malgré Laplace, écrit-il dans "l'Art romantique, "la certitude astronomique n'est pas, aujourd'hui même, si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. À l'heure où Fresnel et Arago développent la théorie ondulatoire de la lumière, l'Espace est confirmé dans son rôle d'Ether, et les mystiques de la Lumière y voient le royaume de l'absolue clarté, celui où l'esprit peut accéder au terme d'une lente montée. Chez Baudelaire (Élévation, 1857), c'est d'un mouvement sûr qu'à travers les abîmes ténébreux et les miasmes morbides de la condition humaine, l'esprit rejoint les espaces limpides pour y boire le feu clair.
Théodore de Banville (1823-1891) s'inscrit en faux contre un certain pessimisme romantique à la Leconte de Lisle. Poète positiviste, il n'éprouve guère d'angoisse devant l'écrasante machinerie cosmique. La Nature nous broie? Certes, mais elle régénère les atomes des morts pour d'autres floraisons. Ce qui donne un sens à l'univers, c'est la vie universelle qui palpite dans les myriades de soleils. Le mouvement expansif, l'identification au tout, se retrouvent dans un poème caractéristique de Jean Rameau (Rêverie, 1886). Saisi d'un sentiment de religiosité cosmique, il veut se persuader qu'il est impossible que tout cela ne serve à rien. Puisque la vie germe partout, la mort terrestre ne peut être définitive.
Parallèlement, la génération des poètes "pessimistes réagit différemment devant l'élargissement du panorama cosmique, en qui elle voit la confirmation que l'univers entier n'est que géhenne, où l'animal naît pour la souffrance et la mort. Monotonie dans le malheur, confusion, tumulte, affolement, voilà ce qu'est l'oeuvre du Créateur. Cette vue s'impose au jeune Laforgue. Il est de ceux qui, frappés par la position marginale du Soleil dans notre galaxie, sont malades à l'idée de n'être pas au centre. L'espace infini, la durée infinie l'obsèdent non pas pour la merveilleuse variété qui peut s'y déployer, mais pour toutes les catastrophes qui s'y sont produites et s'y produiront. On est perdu, on est seul, on va mourir... telle est la litanie qu'il développe dans Le Sanglot de la Terre, ses premiers poèmes rédigés entre 1878 et 1883. Spleen indéfinissable, sentiment exacerbé de la vanité de la vie, de l'amour, de la pensée sont les thèmes favoris d'une certaine poésie "décadente, en vogue en cette fin de siècle.
Au début du XXe siècle, Paul Claudel veut restaurer la dignité de l'homme, en rassemblant autour de lui le cosmos, dont il fait, à la lettre, une "Maison Fermée. Claudel part d'un mauvais procès qu'il intente à la notion d'Infini, dont le caractère vertigineux est, selon lui, délétère pour l'imagination, avilissante pour la dignité humaine et, pour tout dire, responsable de la perte du sens religieux. Cette négation de l'Infini, Claudel l'a trouvée chez Wallace: "La Place de l'Homme dans l'Univers (1903). Or, ce livre n'a aucune objectivité scientifique. L'auteur veut montrer que la place de l'homme est centrale, prépondérante, unique. Il reconstitue un univers circulaire, ordonné, séduisant pour un esprit en quête d'harmonie, rassurant pour qui cherche la stabilité. Wallace restaure le finalisme de la vieille astrologie : les plus faibles radiations des étoiles ont des effets chimiques, caloriques, elles sont toutes orientées vers cette vie terrestre dont l'homme est le sommet. Claudel reprend ces idées dans des écrits en prose à l'argumentation mathématique et philosophique pauvre. Par bonheur, il en sublime le matériau dans ses écrits poétiques. Dans une lettre à André Gide datée du 8 novembre 1908 il prévient : "Ce que peindront mes Odes, c'est la joie d'un homme que le silence éternel des espaces infinis n'effraie plus, mais qui s'y promène avec une confiance familière et, dans sa lettre sur Coventry Patmore: "Nous n'habitons pas un coin perdu d'un désert farouche et impraticable. Tout dans le monde nous est fraternel et familier. La Maison Fermée est sa cinquième Ode, composée à Tsien-Tsien en 1908. On y décèle aussi l'influence de Camille Flammarion. Dans Merveilles célestes (1864), ce dernier avait comparé les points de condensation du brouillard cosmique à "ces petits nids soyeux d'insectes au flanc des branches. Laforgue nous montrait les toiles d'azur "pleines de cotons à fétus d'étoiles (Complainte du Temps et de sa commère l'Espace, 1880). Claudel, lui, y voit "les petites araignées ou certaines larves d'insectes bien cachées dans leur bourse d'ouate et de satin. Claudel a vraisemblablement rencontré un astronome qui lui a montré une photographie de l'amas des Pléiades. Ce groupe d'étoiles visible à l'oeil nu, grossi au télescope et fixé par la photographie, montre en effet des "soleils encore embarrassées aux froids plis de la nébuleuse. Le poète semble y chercher un reste de cocon où blottir son âme frileuse, une protection contre le froid et l'abîme.
Jules Supervielle (1884-1960) répugne au style grandiloquent. Ce grand poète du sentiment cosmique pose un regard fragile sur un univers à la fois familier et fabuleux. Terre et ciel, vie et mort sont agréablement confus et mêlés dans son oeuvre. Le frisson du poète fleurit en images souriantes, telle notre groupe planétaire, qui lui apparaît comme un petit cercle intime, la table de famille entourée de figures connues (La Table, 1925). Dans Le Corps (Fable du monde, 1938), il reprend le concept vitaliste du Grand Animal -- Univers. Faisant sourdre le merveilleux du quotidien, il abolit les frontières entre les degrés de la création, et rapproche, de façon moins solennelle et sans doute plus convaincante que Claudel, l'homme et l'Univers.
Supervielle a aidé Patrice De la Tour du Pin à publier ses premiers poèmes, qui restent son chef-d'oeuvre : La Quête de Joie (1933). Élevé à la campagne, le poète-aristocrate est resté imprégné de ses lectures religieuses, et d'une relation familière avec la nature.
Tout autre fut le destin de Luc Dietrich (1912-1944). Placé à l'âge de neuf ans dans un asile de jeunes anormaux, il y reste deux ans, puis connaît une existence indécise avant de se faire entretenir par une reine du Milieu. Dès lors il vit parmi les truands, s'adonne au trafic de drogue. Mais Lanza del Vasto, qu'il rencontre, décèle en lui un poète autodidacte merveilleusement doué. Révélé à lui-même, Dietrich compose L'Injuste Grandeur peu avant de mourir.
Lié avec Dietrich et mort la même année, René Daumal construit son poème Contre-Ciel -- Poésie noire, poésie blanche (posth., 1954) autour d'un Non vécu, hurlé. À la fin jaillit l'éclair de vérité, de liberté. Obligeant ainsi à prendre conscience du réel, le Non élève à la compréhension de l'universel.
Du Maître d'astres et de navigation, de Saint-John Perse (Amers, 1957) est un chant en l'honneur de la mer, mais, comme chez Richepin (quoique avec la maîtrise supérieure d'une langue superbe et difficile), la mer est symbole de l'une des patries de notre imaginaire pouvant tout aussi bien se confondre avec l'espace. "Et de la mer elle-même il ne sera pas question, mais de son règne au coeur de l'homme, écrit le poète dans la préface de son recueil.
Qu'en est-il aujourd'hui de cette relation de parenté entre l'homme et le cosmos, revendiquée par Claudel ? Ce dernier eût été enchanté de la réapparition de modèles cosmologiques fermés, dans le cadre de la relativité einsteinienne. Mais qu'importe l'extension finie ou infinie de l'espace ! Toute interprétation de données scientifiques en vue de telle ou telle vision philosophique relative au rapport homme-cosmos est affaire de tempérament. Les uns seront glacés, les autres réconfortés par le changement de paradigme cosmologique (espace courbe, univers en expansion, big bang). Dans un livre de vulgarisation scientifique paru en 1946, Énergie atomique et univers, J. Thibaud a fait remarquer que la solution de l'espace courbe "apaise notre frayeur devant l'infini comme notre répugnance à concevoir le néant; elle a "d'incontestables avantages esthétiques. Quant à la théorie de l'abbé Lemaître, selon laquelle l'Univers naît de l'éclatement d'un atome primitif -- la future théorie du big bang -- elle lui confère une "admirable unité.
Les avancées astrophysiques dans le domaine de l'évolution stellaire se sont avérées les plus fécondes pour alimenter l'imaginaire des Parménidiens du XXe siècle. Elles nous apprennent que l'émergence de la complexité est le fruit d'une longue histoire, impliquant l'univers tout entier depuis quinze milliards d'années. Chaque atome de notre corps a été forgé au sein de générations d'étoiles aujourd'hui disparues. La conscience, l'homme, et plus généralement la vie, sont au sens propre les "enfants" des étoiles. Dans ce schéma de pensée, l'homme comprend que c'est à la démesure même de l'univers qu'il doit sa propre existence. Ni centre, ni sommet, mais indéfectible maillon dans l'évolution cosmique, l'homme sait qu'il doit un jour disparaître, mais il aura au moins compris pourquoi il est apparu, et pourquoi il disparaîtra.
Pour populariser cette nouvelle vision du monde, pour rendre sensible au lecteur ingénu le pathos des grandes dimensions4 , il faut des hommes de culture scientifique -- des astronomes de profession, ce qui rassure à la fois observateurs, naturalistes, modélisateurs, érudits, bref des familiers des espaces célestes qui pourraient dire : "J'en viens ! Il y a eu Camille Flammarion, il y a aujourd'hui Hubert Reeves5 . Leur belle figure barbue prend, auprès de l'amateur, la place de la Béatrice de Dante et autres guides surnaturels des anciens voyages célestes. Et on les suit aussi les yeux fermés quand ils extrapolent hors de leur domaine propre.
Il ont plus ou moins marqué les poètes qui, selon le mot de Laforgue, "séjournent dans le cosmique. Moins décelable, non moins importante, est leur influence sur ceux qui n'ont pas eu accès à la culture universitaire, sur les autodidactes, ce vivier plein de fraîcheur qu'est l'imagination populaire. Grâce à eux, que de rêveurs de province se sont évadés par le haut d'une existence morne, exploitant la plus précieuse richesse des Cévennes ou de la Haute-Provence : un ciel pur de toute pollution, fourmillant d'une vie stellaire scintillante ! Combien de penseurs et d'écrivains auront-ils eu un grand-père en qui ces livres illustrés ont éveillé le sentiment cosmique ?
Un sentiment cosmique bien présent chez les grands poètes d'aujourd'hui: Yves Bonnefoy (Le Haut du Monde), Jean Rousselot (Poèmes en espoir de cause), Jean Orizet (Hommes continuels). Salutaires exercices de l'imagination créatrice, en un temps où pour le grand public, le sens originel du mot cosmos s'est dégradé.
Les astres nous renvoient la question intacte, nous dit Jean Orizet. Telle devrait être la conclusion de cette anthologie. Je me risque toutefois à finir sur une note personnelle. Il y a quelques années, je vivais seul dans un petit appartement du boulevard Arago, à Paris, à quelques pas de l'Institut d'astrophysique. Presque chaque matin, je croisais en bas de l'immeuble un vieil homme fatigué, en pantoufles et robe de chambre élimées, venant chercher dans la petite boîte aux lettres un signe de l'extérieur. Enfermés dans nos solitudes respectives, nous ne nous sommes jamais parlés. Je n'ai regardé son nom sur la boîte que le jour où j'ai déménagé. Il y avait marqué dessus : Jean Tardieu. Quelques semaines plus tard, j'ai appris sa mort... Alors, en relisant "Le ciel ou l'irréalité", qu'il avait composé entre 1950 et 1961, un torrent d'images a déferlé... Je l'ai vu, seul dans son modeste appartement, prisonnier des quatre murailles qui sont les murailles de la vie, ressentant toute la lourdeur du monde. Mais dès que la nuit vient, les parois s'effacent, le théâtre s'agrandit, son esprit gagne les hauteurs, s'envole vers le ciel, vers ce pays de l'irréalité qu'il appelle sa patrie. Ma patrie. Votre patrie...
Jean-Pierre Luminet
1. Aux sources de la présence, 1985
2. Rub signifie quatrain en persan
4. L'expression est du philosophe américain Arthur Lovejoy.
5. Dont l'un des ouvrages à succès a pour titre un vers emprunté à Valéry : Patience dans l'azur...
|
|
Omar Khayyam : Quatrains
Le vaste monde : un grain de poussière dans l'espace
Toute la science des hommes : des mots
Les peuples, les bêtes et les fleurs des sept climats : des ombres
Le résultat de ta méditation : rien.
Si je pouvais être le maître, comme Dieu,
Je saurais démonter le ciel au beau milieu.
Et je ferais alors, au milieu des étoiles,
Un autre ciel, où l'homme atteindrait tous ses voeux.
C'est à cause du Ciel que mon coeur est farouche.
C'est Lui qui déchira mon bonheur en lambeaux.
L'air qu'il souffle sur moi m'est le feu d'un flambeau
Et l'eau a pris un goût de terre dans ma bouche.
Nous sommes des jouets entre les mains du Ciel
Qui nous déplace comme Il veut : c'est notre maître.
Au jeu d'échecs, nous sommes des pions éternels
Qui tombent un à un tout au fond du non-être.
Cette céleste Roue à nos yeux suspendue
Est lanterne magique étonnant notre vue.
Du milieu, le soleil éclaire la lanterne,
Et nous tournons autour, images éperdues.
De la ronde éternelle, arrivée et départ,
Le début et la fin échappent au regard.
D'où venons-nous, où allons-nous? Jamais personne
N'a dit la vérité là-dessus nulle part.
Jacques Peletier du Mans : L'amour des amours
Ô Ciel puissant ! ô Univers immense !
Ô Tout qui est enclos en ta rondeur!
Ô hauteur claire ! ô noire profondeur !
Ô Un! ô deux, dont tout l'Œuvre commence !
Ô mouvements ! Ô première semence !
Oh! Si je suis de toute la grandeur
Quelque seul point, que j'aie au moins tant d'heur
D'avoir ma part d'un seul point de clémence.
Brûle mon feu, ô feu plus vertueux ;
Noyez mon eau, ô flots plus fluctueux ;
Revenge-moi de l'Air, ô Terre gloute ;
Revenge-moi, ô Mort, de celle-là
Qui de pitié n'a une seule goutte,
Et tant se plaît à perdre ce qu'elle a.
Djala-l al-Din Ru-mi- : Ruba-`iyya-t
Ces mondes célestes, limite de notre connaissance,
Dans la main de la puissance divine sont moindres qu'une brindille.
Chaque atome et chaque goutte seraient-ils une baleine,
Tout ce qui existe est comme un poisson dans la mer
Ô roue du firmament ! Par la ruse et la fraude,
Tu as gagné au jeu sur l'échiquier de mon coeur!
Tu me verras un jour à la table du ciel
Prendre des coupes pareilles à la lune.
|
|
Tommaso Campanella : Sonnets
ÂME IMMORTELLE
Dans une poignée de cervelle je tiens, mais dévore
Tant qu'autant de livres que tienne le monde
N'ont pu rassasier mon appétit profond.
Que j'ai mangé ! Et je meurs encore de faim.
D'un grand monde Aristarque, et Métrodore3
De plusieurs, m'ont nourri. Et ma faim a grandi encore.
Désirant et sentant je tourne et tourne en cercles.
Et plus je comprends, plus j'ignore.
Je suis donc bien l'image du Père immense
Qui les êtres, comme la mer les poissons, enclôt
Et qui est seul objet du sens aimant
Pour qui le syllogisme est flèche qui vise la cible,
L'autorité la main d'un autre. Donc je tiens celui-là seul
Pour assuré de liesse, qui devient Lui et s'en imprègne.
DU MONDE ET DE SES PARTIES
Le monde est animal grand et parfait,
Statue de Dieu, qui loue Dieu à qui il ressemble.
Nous sommes, nous, vers imparfaits, vile famille
Qui dans son ventre avons vie et séjour.
Et son amour nous ignorons, et sa lumière.
Mais le ver dans mon ventre, non plus, n'a souci
De me connaître, mais à me faire mal s'attache.
Il faut donc procéder avec égards extrêmes.
Et puis, nous sommes sur la Terre, grand
Animal dans le plus grand, comme les poux
Sur notre corps. Or, ils nous font du mal.
Gent orgueilleuse, avec moi levez les yeux
Et mesurez ce que vaut chaque être.
De ce point, apprenez quelle part est la vôtre.
3. Au IIIe siècle avant J.-C., Aristarque de Samos formula l'hypothèse d'un univers héliocentrique, et Métrodore défendit la théorie des mondes multiples dans un espace infini.
|
Alexander Pope : Essai sur l'homme
Celui-là seul dont l'oeil, perçant l'immensité,
Voit des globes, divers de masses et de clarté,
Former, monde sur monde, orbites sur orbites,
Ce splendide univers où tout dans ses limites
S'engrène sans secousse et tourne sans effort ;
Qui voit, loin du soleil, mille soleils encor
Circuler, escortés de planètes légères ;
Qui sait quels habitants peuplent ces hautes sphères ;
Celui-là, mais lui seul, pourrait, s'il le voulait,
Dire pourquoi sa main fit l'homme ce qu'il est.
Dis, est-ce toi dont l'âme, en tous sens épandue,
Surprit tous les secrets de l'immense étendue ;
Qui de cette machine aux merveilleux ressorts
Mesuras les liens, les leviers, les supports,
L'échelle qui régla leurs forces assorties ?
Un tout peut-il s'enclore en l'une des parties ?
Cette invisible chaîne, appui de l'univers,
Qui concilie entre eux tant de types divers
Et fait que chaque espèce à son rang se maintienne,
Est-ce la main de Dieu qui la porte, ou la tienne ?
(...)
Tourne partout les yeux. Dans l'abîme des mers,
Sur ce compact sol, dans l'infini des airs,
Sans relâche, partout la matière fermente,
Germe, couve, conçoit, féconde, éclôt, enfante.
Magnifique spectacle ! À quelle profondeur,
Sur quel vaste rayon, jusqu'à quelle hauteur
La vie autour de nous, sous nos pieds, sur nos têtes,
De progrès en progrès, par des routes secrètes,
Dans le double infini roule, monte et descend !
Chaîne immense de vie, au sein de Dieu naissant,
Qui, s'abaissant, relie à la Cause Première
Les anges, purs esprits, l'homme, esprit et matière,
Les êtres sensitifs, innombrables chaînons,
Quadrupèdes, oiseaux, êtres rampants, poissons,
Insectes dont notre oeil cherche en vain l'existence
Et qui du microscope attestent l'impuissance !
Rivée à l'Infini, son éternel soutien,
Elle descend à l'homme et de l'homme à ce rien !
Eh bien ! si, dédaignant son humble part de chaîne,
L'homme, pour envahir la station prochaine
Expulsait de leur rang les Esprits radieux,
L'animal, à son tour, d'un bond ambitieux,
Sur l'anneau déserté s'élancerait, avide,
Ou, s'il gardait son poste, il laisserait un vide
Dans le plein absolu de la création ;
Mais toute échelle croule, où croule un échelon ;
Et, quel qu'en soit le rang, s'il se brise, l'échelle,
L'immense échelle craque et le monde chancelle !
(...)
Que la Terre égarée échappe à son orbite,
Les planètes sans frein, les astres turbulents
Se rueront dans l'espace en écarts violents.
Que des globes de feu confiés à leur zèle
Les anges détrônés, de la voûte éternelle
Tombent et dans leur chute entraînent confondus
Êtres, mondes, soleils dans l'abîme perdus,
Sur sa base d'airain jusqu'au centre ébranlés,
Tremble du firmament la sphère dépeuplée ;
Le monde chancelant sur son puissant essieu
Propage son effroi jusqu'au trône de Dieu.
Ainsi tout s'éteindrait ! Une immense ruine
Détruirait l'univers, pour qui ? pour toi, vermine !
Ô sottise ! ô folie ! orgueil ! impiété !
|
Walt Whitman : Cosmos
Est un cosmos celui qui contient la diversité et qui est la Nature,
Celui qui est l'amplitude de la terre, et la rudesse, et la sexualité de la terre, et la grande charité de la terre, et son équilibre aussi,
Celui qui n'a pas regardé pour rien par les fenêtres de ses yeux,
ou dont le cerveau n'a pas donné audience à ses messagers pour rien,
Celui qui contient les croyants et les incroyants,
celui qui est le plus majestueux aimeur,
Celui ou celle qui renferme exactement sa proportion trinitaire de réalisme,
de spiritualisme et d'élément esthétique ou intellectuel,
Celui qui, ayant considéré le corps,
trouve que tous ses organes et toutes ses parties sont bien,
Celui ou celle qui, à l'aide de la théorie de la terre et de celle de son corps,
comprend par des analogies subtiles toutes les autres théories,
La théorie d'une ville, d'un poème et de la large politique de ces États ;
Celui qui croit non seulement en notre globe avec son soleil et sa lune,
mais en les autres globes avec leurs soleils et leurs lunes,
Celui ou celle qui, en construisant sa demeure, non pour un jour,
mais pour tout le temps, voit les races, les âges, les périodes, les générations,
Le passé, le futur qui y habitent, comme l'espace, inséparablement unis.
|
|
Charles Baudelaire : Élévation
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ;
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins ;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
-- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !
Théodore de Banville : Le vieillard
Nous qui n'avons pas peur de Dieu
Comme le dévôt en démence,
Au-dessus de la ville immense
Regardons gaiement le ciel bleu.
Nous mourrons ; mais, ô souveraine,
Ô mère, ô nature sereine,
Sous les calmes cieux rougissants
Tu prendras nos cendres inertes
Pour en faire des forêts vertes
Et des bouquets resplendissants.
Buvons au problème inconnu,
Et buvons à ta beauté blonde.
|
Jules Laforgue : Le Sanglot Universel
Ah ! la Terre n'est pas seule à hurler, perdue !
Depuis l'Éternité combien d'astres ont lui,
Qui sanglotaient semés par l'immense étendue,
Dont nul ne se souvient ! Et combien aujourd'hui !
Tous du même limon sont pétris, tous sont frères,
Et tous sont habités, ou le seront un jour,
Et comme nous, devant la vie et ses misères
Tous désespérément clament vers le ciel sourd.
Les uns, globes fumants et tièdes, n'ont encore
Que les roseaux géants dont les râles plaintifs
Durant les longues nuits balayent l'air sonore
Sous le rude galop des souffles primitifs.
D'autres ont les troupeaux de mammouths et les fauves
Et c'est la faim, le rut et leurs égorgements.
Et les faibles, le soir, du haut des grands pics chauves,
Vers la Lune écarlate ululent longuement.
Sur d'autres l'homme est né. Velu, grêle, il déloge
Ses aines de l'abri des puissantes forêts.
Un cadavre l'arrête, il s'étonne, interroge,
Dès lors monte la voix des grands misérérés.
Et c'est la Terre. Ah ! nous sommes bien vieux, nous autres !
Nous savons désormais que nul là-haut n'entend,
Que l'univers n'a pas de coeur sinon les nôtres
Et toujours vers un coeur nous sanglotons pourtant.
Ceux enfin où Maïa l'Illusion est morte,
Solitaires, muets, flagellés par les vents,
Ils n'ont dans le vertige encor qui les emporte
Que la rauque clameur de leurs vieux océans.
Et tous ces archipels de globes éphémères
S'enchevêtrent poussant leurs hymnes éperdus
Et nul témoin n'entend, seul au-dessus des sphères,
Se croiser dans la nuit tous ces sanglots perdus !
Et c'est toujours ainsi, sans but, sans espérance...
La Loi de l'Univers, vaste et sombre complot
Se déroule sans fin avec indifférence
Et c'est à tout jamais l'universel sanglot !
14 novembre 1880.
|
Jules Laforgue : Éclair de gouffre
J'étais sur une tour au milieu des étoiles !
Soudain, coup de vertige. Un éclair où, sans voiles,
Je sondais grelottant d'effarement, de peur,
L'énigme du Cosmos dans toute sa stupeur !
Tout est-il seul ? Où suis-je ? Où va ce bloc qui roule
Et m'emporte ? -- Et je puis mourir ! mourir, partir,
Sans rien savoir ! Parlez ! Ô rage, et le temps coule
Sans retour ! Arrêtez ! arrêtez ! et jouir ?
Car j'ignore tout, moi ! Mon heure est là peut-être:
Je ne sais pas ! J'étais dans la nuit, puis je nais.
Pourquoi ? D'où l'univers ? Où va-t-il ? Car le prêtre
N'est qu'un homme. On ne sait rien ! Montre-toi, parais,
Dieu, témoin éternel ! Parle, pourquoi la vie ?
Tout se tait ! Oh ! l'espace est sans coeur ! Un moment !
Astres ! Je ne veux pas mourir ! J'ai du génie !
Ah ! redevenir rien irrévocablement !
28 octobre 1880.
|
|
Paul Claudel : La Maison Fermée
Ô certitude et immensité de mon domaine !
Ô cher univers entre mes mains connaissantes !
Ô considération du nombre parfait à qui rien ne peut être soustrait ou ajouté !
Ô Dieu, rien n'existe que par une image de votre perfection !
Est-ce qu'aucune de vos créatures peut vous échapper ? Mais vous les tenez captives par des règles aussi sévères que celle d'un coeur pénitent et avec une loi ascétique.
Et vous qui connaissez le nombre de nos cheveux, est-ce que vous ignorez celui de vos étoiles ?
Tout l'espace est rempli des bases de votre géométrie, il est occupé avec un calcul éclatant pareil aux computations de l'Apocalypse.
Vous avez posé chaque astre miliaire en son point pareil aux lampes d'or qui gardent votre sépulture à Jérusalem.
Et moi, je vois tous vos astres qui veillent, pareils aux Dix Vierges sages à qui l'huile ne fait pas défaut.
Maintenant je puis dire, mieux que le vieux Lucrèce : Vous n'êtes plus, ô terreurs de la nuit !
Ou plutôt comme votre saint Prophète : "Et la nuit est mon exultation dans mes délices !"
Réjouis-toi, mon âme, dans ces vers ambrosiens !
Je ne vous crains point, ô grandes créatures célestes !
Je sais que c'est moi qui vous suis nécessaire et je me tiens comme un pilote dans vos feux entre-croisés,
Et je vous ris aux yeux comme Adam aux bêtes familières.
Toi, ma douce petite étoile entre les doigts de ma main comme une pomme cannelle !
Pas une chose qui ne soit nécessaire aux autres.
(...)
Ô capture ! Ô pêche miraculeuse ! Ô million d'étoiles prises aux mailles de notre filet,
Comme un grand butin de poissons à demi sorti de la mer dont les écailles vivent à la lueur de la torche !
Nous avons conquis le monde et nous avons trouvé que Votre Création est finie,
Et que l'imparfait n'a point de place avec Vos oeuvres finies, et que notre imagination ne peut pas ajouter
Un seul chiffre à ce Nombre en extase devant Votre Unité !
Comme jadis quand Colomb et Magellan eurent rejoint les deux parts de la terre,
Tous les monstres des vieilles cartes s'évanouirent,
Ainsi le Ciel n'a plus pour nous de terreur, sachant que si loin qu'il s'étend
Votre mesure n'est pas absente. Votre bonté n'est pas absente
Et nous considérons Vos étoiles au ciel
Paisiblement comme des brebis pleines et comme des ouailles paissantes,
Aussi nombreuses que la postérité d'Abraham.
Comme on voit les petites araignées ou de certaines larves d'insectes comme des pierres précieuses bien cachées dans leur bourse d'ouate et de satin,
C'est ainsi que l'on m'a montré toute une nichée de soleils encore embarrassés aux froids plis de la nébuleuse.
|
|
Jules Supervielle : La Table
Des visages familiers
Brillent autour de la lampe du soleil.
Les rayons touchent les fronts
Et parfois changent de front
Oscillant de l'un à l'autre.
Des explosions d'irréel dans une fumée blanchissante
Mais nul bruit pour les oreilles :
Un fracas au fond de l'âme.
Des gestes autour de la table
Prennent le large, gagnent le haut-ciel,
Entre-choquent leurs silences
D'où tombent des flocons d'infini.
Et c'est à peine si l'on pense à la Terre
Comme à travers le brouillard d'une millénaire tendresse.
L'homme, la femme, les enfants,
À la table aérienne
Appuyée sur un miracle
Qui cherche à se définir.
Il est là une porte toute seule
Sans autre mur que le ciel insaisissable,
Il est là une fenêtre toute seule,
Elle a pour chambranle un souvenir
Et s'entrouvre
Pour pousser une léger soupir.
L'homme regarde par ici, malgré l'énorme distance,
Comme si j'étais son miroir,
Pour une confrontation de rides et de gêne.
La chair autour des os, les os autour de la pensée
Et au fond de la pensée une mouche charbonneuse.
Il s'inquiète
Comme un poisson qui saute
À la recherche d'un élément,
Entre la vase, l'eau et le ciel
Le ciel est effrayant de transparence,
Le regard va si loin qu'il ne peut plus vous revenir.
Il faut bien le voir naufrager
Sans pouvoir lui porter secours.
Tout à coup le soleil s'éloigne jusqu'à n'être plus qu'une étoile perdue
Et cille.
Il fait nuit, je me retrouve sur la Terre cultivée.
Celle qui donne le maïs et les troupeaux
Les forêts belles au coeur.
Celle qui ronge nuit et jour nos gouvernails d'élévation.
Je reconnais les visages des miens autour de la lampe
Rassurés comme s'ils avaient
Échappé à l'horreur du ciel
Et le lièvre qui veille en nous se réjouit dans son gîte ;
Il hume son poil doré
Et l'odeur de son odeur, son coeur qui sent le cerfeuil.
|
|
René Daumal : Contre-Ciel
L'être humain est une superposition de cercles vicieux. Le grand secret, c'est qu'ils tournent bien d'eux-mêmes. Mais les centres de ces cercles sont eux-mêmes sur un cercle ; l'homme sort du dernier pour rentrer dans le premier. Cette révolution n'échappe pas aux yeux des sages; eux seuls échappent au tourbillon et en le quittant le contemplent.
-- Harmonie des sphères, cosmique des dieux, astres-dieux de la pensée, brûlants systèmes forgés de chair en chair, qu'elle soit rouge de sang, orangée de rêve ou jaune de méditation; les astrolabes perce-coeur chauffés à blanc, loin des pièges à bascule, sous les escaliers du démon, et l'air vif du large qui déjà s'épaissit en boue. La trajectoire réelle de l'acier céleste à travers la gorge pendant que les
hommes d'en bas s'exercent à éternuer --
car on voit tout de là-haut, et tout est vrai de
plus de mille façons, mais toutes ces façons de comprendre ne valent que réunies, bloc-un-tout, dieu blanc-noir, zèbre céleste et plus rapide...
oh ! dites moi, les sauvages n'ont-ils jamais élevé dans la forêt vierge la monstrueuse statue du Zèbre-dieu?
dieu de toutes les contradictions résolues entre quatre
lèvres : et ce n'est même plus la peine, l'élan est
donné et le monde croule, et la lumière n'a pas besoin de prismes pour se disperser, et tout le réel changeant immuable
-- choc des mots, folie inévitable
des discours humains, choc-colère cahotant ses cris, ses faux espoirs -- escroquerie de Prométhée, qu'il est beau,
qu'il est beau ! Prométhée, victoire
pantelante soumise aux langues de feu, avec la couronne tourbillonnante des soleils, les petits alliés des Hommes... Mais les grands anti-soleils noirs, puits de vérité dans la trame essentielle, dans le voile gris du ciel courbe vont et viennent et s'aspirent l'un l'autre,
et les hommes les nomment absences.
Qui leur apprendra ce qu'est l'être, et qu'ils ne font que
peser le non-être à leur mesure ?
Soumis aux langues de feu, tournez votre visage
vers les flammes, vers le baiser divin qui vous arrachera les dents d'un seul coup.
|
Jules Supervielle : La Fable du Monde
Ici l'univers est à l'abri dans la profonde température de l'homme
Et les étoiles délicates avancent de leurs pas célestes
Dans l'obscurité qui fait loi dès que la peau est franchie,
Ici tout s'accompagne des pas silencieux de notre sang
Et de secrètes avalanches qui ne font aucun bruit dans nos parages,
Ici le contenu est tellement plus grand
Que le corps à l'étroit, le triste contenant...
Mais cela n'empêche pas nos humbles mains de tous les jours
De toucher les différents points de notre corps qui loge les astres,
Avec les distances interstellaires en nous fidèlement respectées.
Comme des géants infinis réduits à la petitesse par le corps humain, où il nous faut tenir tant bien que mal,
Nous passons les uns près des autres, cachant mal nos étoiles, nos vertiges,
Qui se reflètent dans nos yeux, seules fêlures de notre peau.
Et nous sommes toujours sous le coup de cette immensité intérieure
Même quand notre monde, frappé de doute,
Recule en nous rapidement jusqu'à devenir minuscule et s'effacer,
Notre coeur ne battant plus que pour sa pelure de chair,
Réduits que nous sommes alors à l'extrême nudité de nos organes,
Ces bêtes à l'abandon dans leur sanglante écurie.
|
Patrice de la Tour du Pin : Épiphanie
Une forêt, la nuit et sans pénombre
Avec des arbres droits et clairsemés,
Et l'éclat du cristal à l'extrémité des branches.
Pour se mouvoir à pas lents vers la lumière,
Les yeux abîmés dans le ciel :
Laisse ton livre pour la contemplation du ciel,
La naissance végétale de l'aube.
Au lieu des escaliers surchargés de pierreries,
Une montée, la nuit, entre des arbres transparents,
Le compagnon spirituel à mes côtés
Qui ouvre des yeux adorablement beaux.
Où courez-vous entre les rangs de jeunes frênes ?
Nous avons eu mal aux vertèbres de nos cous
Pour avoir trop jeté la tête en arrière,
-- L'étoile que nous dépassions.
Il faut partir, me dit l'ami spirituel,
Donnez-moi votre main pour l'heure de l'envol,
Je ne sens déjà plus la même attirance
De la terre -- mais l'autre, prodigieuse, grandit...
Les arbres, ils étaient droits et clairsemés ;
Il me souffla : C'est l'heure...
Nous sentîmes les branches qui frôlaient nos visages.
L'air vif battit nos fronts quand ils les dépassèrent...
Il se tenait très loin et seul,
Et tout le ciel était tendu vers Lui.
Et nous chantions avec des voix qui ressemblaient
À celles des branches, avec un son de voix
Qui pouvait être celui du vent dans les branches :
Joie, Joie ! car l'homme est sur ses fins !
Une pente indicible de blancheur,
Foulable aux pieds, non pas imaginaire,
Où montaient de grands équipages de rois.
Venus par vagues des villes abandonnées,
Avec leurs ombres
Et les dons les plus beaux de toute la terre.
Pour graviter si lentement dans la lumière
Autour de Lui :
Laisse tes autres sens pour la gravitation dans la lumière...
Et nous chantions avec des voix qui ressemblaient
À celles des Anges, avec un son de voix
Qui ressemblait à l'extase des Anges :
Joie, Joie ! car l'homme est sur ses fins !
Il se fit un arrêt de toute vie actuelle,
Nous étions suspendus par l'amour,
Les bras en croix qui nous portaient dans l'air.
Une vague immense monta jusqu'au solstice,
Laissant un sillage derrière elle
Que d'autres vagues effaçaient.
Nous approchions si lentement de son visage,
Nos yeux se tendaient vers ses yeux
Nous ne vivions plus que par le désir...
Il eût fallu des prunelles beaucoup plus larges,
Pour contenir sa lumière merveilleuse,
Et les nôtres brûlaient telles des torches.
Alors nous fûmes tous poussés vers une même voie :
Elle se déroula comme une nébuleuse
Et des milliers d'oiseaux polaires...
Luc Dietrich : La chaîne des éléments
L'homme qui cherche est comme sur une plage, couché entre nuit et jour, entre sécheresse et brume, entre ciel et terre.
Devant lui c'est la mer des naissances et des descentes, et derrière lui et en lui court et stagne l'eau des oublis et des abandons, et le voyage liquide des plaisirs subis.
Le feu est en lui comme il est sous la terre : feu de colère, feu de désir, feu de haine, feu caché, brûlure sans offense, feu dont il a brûlé de trous la grande trame des verdures ardentes, des troncs, des monts, des fleurs de braise, des étincelles d'insectes, la coulée des mers, le lingot des glaciers et tout ce qu'a forgé ce feu céleste dont son oeil était pourtant fait, et sali de fumée le passage de ses grands jours torrentiels couleur de soleil.
Il est couché sur cette plage et son coeur de terre bat contre terre. Il est comme chaque chose car chaque chose est attachée à la terre, retombant sur soi-même, couchée dans ses limites. Et c'est pourquoi l'animal prisonnier dans sa fuite, l'oiseau qui pèse sur son vol, la plante empêchée dans sa souche, l'insecte tueur et l'homme, restent sourds à son appel et sourde cette caverne qu'est son propre corps où tant de grappes de vie s'enfièvrent.
Il respire, un souffle ardent le soulève, sa vie est une vague à la surface de l'air ; de l'air invisible et dénué de mystère, peuplé de fantômes, de boules de vent qui fondent et deviennent tempête. Et lui-même bourdonne de mots jusque dans son sommeil.
Oui, l'homme qui cherche est accablé, mais par sa petitesse et non par la grandeur du monde. Il souffre d'être cette main qui lésine, ce regard boueux, cette ouïe décevante, ce coeur étriqué, ces sens toujours en désaccord.
Et tandis qu'il se hait de n'être qu'une forme mesquine, il pleure sur le destin de cette forme qui est d'être balayée et reprise, recouverte et noyée, et de ce que son soupir et sa plainte, son espoir et son erreur demeurent sans témoin.
Il ne souffre pas de l'accablement de ce grand monde qui est allégé par en haut.
Mais ce monde a pour toit l'éther massif, dur comme l'acier noir, froid comme le basalte sans veine, tombeau de toutes les gloires et de tous les désastres, bronze où sonne le moindre bruit, cire vierge où les gestes secrets s'impriment pour toujours. Lieu solide gardant nos mondes mous. Vide que toute voix émeut, qu'un mouvement d'algue anime, qu'un doute raye ; champ de nébuleuses et sillons de soleils épaissis de nos morts innombrables. Océan froid où brûlent les comètes, où les trajectoires s'enchevêtrent, où les astres se cassent sans souci de durée.
Alors l'homme cherche Dieu entre les branches de la nuit.
|
|
|
Saint-John Perse : Du Maître d'astres et de navigation:
Ils m'ont appelé l'Obscur, et mon propos était de mer.
L'Année dont moi je parle est la plus grande Année ; la Mer où j'interroge est la plus grande Mer.
Révérence à ta rive, démence, ô Mer majeure du désir...
La condition terrestre est misérable, mais mon avoir immense sur les mers, et mon profit incalculable aux tables d'outre-mer.
Un soir ensemencé d'espèces lumineuses
Nous tient au bord des grandes Eaux comme au bord de son antre la Mangeuse de mauves,
Celle que les vieux Pilotes en robe de peau blanche
Et leurs grands hommes de fortune porteurs d'armures et d'écrits, aux approches du roc noir illustré de rotondes, ont coutume de saluer d'une ova tion pieuse.
Vous suivrai-je, Comptables ! et vous Maîtres du nombre !
Divinités furtives et fourbes, plus que n'est, avant l'aube, la piraterie de mer ?
Les agioteurs de mer s'engagent avec bonheur
Dans les spéculations lointaines : les postes s'ouvrent, innombrables, au feu des lignes verticales...
Plus que l'Année appelée héliaque en ses mille et milliers
De millénaires ouverte, la Mer totale m'environne. L'abîme infâme m'est délice, et l'immersion, divine.
Et l'étoile apatride chemine dans les hauteurs du Siècle vert,
Et ma prérogative sur les mers est de rêver pour vous ce rêve du réel...
Ils m'ont appelé l'Obscur et j'habitais l'éclat.
Secret du monde, va devant ! Et l'heure vienne où la barre
Nous soit enfin prise des mains !... J'ai vu glisser dans l'huile sainte les grandes oboles ruisselantes de l'horlogerie céleste,
De grandes paumes avenantes m'ouvrent les voies du songe insatiable,
Et je n'ai pas pris peur de ma vision, mais m'assurant avec aisance dans le saisissement, je tiens mon oeil ouvert à la faveur immense, et dans l'adulation.
Seuil de la connaissance ! avant-seuil de l'éclat !... Fumées d'un vin qui m'a vu naître et ne fut point ici foulé.
La mer elle-même comme une ovation soudaine ! Conciliatrice, ô Mer, et seule intercession !... Un cri d'oiseau sur les récifs, la brise en course à son office,
Et l'ombre passe d'une voile aux lisières du songe...
Je dis qu'un astre rompt sa chaîne aux étables du Ciel. Et l'étoile apatride chemine dans les hauteurs du Siècle vert... Ils m'ont appelé l'Obscur et mon propos était de mer.
Révérence à ton dire, Pilote. Ceci n'est point pour l'oeil de chair,
Ni pour l'oeil blanc cilié de rouge que l'on peint au plat-bord des vaisseaux. Ma chance est dans l'adulation du soir et dans l'ivresse bleu d'argus où court l'haleine prophétique, comme la flamme de feu vert parmi la flore récifale.
Dieux ! nul besoin d'arômes ni d'essences sur les réchauds de fer, à bout de promontoires,
Pour voir passer avant le jour, et sous ses voiles déliés, au pas de sa féminité, la grande aube délienne en marche sur les eaux...
Toutes choses dites dans le soir et dans l'adulation du soir.
Et toi qui sais, Songe incréé, et moi, créé, qui ne sais pas, que faisons-nous d'autre, sur ces bords, que disposer ensemble nos pièges pour la nuit ?
Et Celles qui baignent dans la nuit, au bout des îles à rotondes,
Leurs grandes urnes ceintes d'un bras nu, que font-elles d'autre, ô pieuses, que nous-mêmes ?...
Ils m'ont appelé l'Obscur et j'habitais l'éclat.
|
Yves Bonnefoy : Le Haut du monde
Je sors,
Il y a des milliers de pierres dans le ciel,
J'entends
De toute part le bruit de la nuit en crue.
Est-il vrai, mes amis,
Qu'aucune étoile ne bouge ?
Est-il vrai
Qu'aucune de ces barques pourtant chargées
D'on dirait plus que la simple matière
Et qui semblent tournées vers un même pôle
Ne frémisse soudain, ne se détache
De la masse des autres laissée obscure ?
Est-il vrai
Qu'aucune de ces figures aux yeux clos
Qui sourient à la proue du monde dans la joie
Du corps qui vaque à rien que sa lumière
Ne s'éveille, n'écoute ? N'entende au loin
Un cri qui soit d'amour, non de désir ?
VII
Ô galaxies
Poudroyantes au loin
De la robe rouge.
Rêves,
Troupeau plus noir, plus serré sur soi
que les pierres.
Je vais,
Je passe près des amandiers sur la terrasse.
Le fruit est mûr.
J'ouvre l'amande
Et son coeur étincelle.
Je vais.
Il y a cet éclair immense devant moi,
Le ciel,
L'agneau sanglant dans la paille.
Jean Rousselot : Poèmes en espoir de cause
I
À l'évidence nul n'est tenu
C'est seulement de loin en loin
Que nous bouleverse
Comme un orgasme ou la mort d'un ami
La parfaite symétrie des murs
Des meubles et de la lampe
Le reste du temps
Distraits par le bruit de fond des planètes
Nous broutons la mort qui verdoie
Comme ailleurs
Dans ce mandala sans sagesse ni magie.
II
Les sentiments se portaient mieux
Quand la terre était plate
Et la perspective incréée
Pas besoin alors d'être insensé
Comme aujourd'hui
Pour croire à l'éternité
Elle était notre ordinaire.
III
Si le temps était encore à naître
Nous saurions si c'est en espoir de cause
Ou seulement par jeu
Que l'esprit agite
Son trousseau de planètes dans l'espace
IV
Pendant que Monsieur Krishna
Prophétise que le temps
Avalera les mondes
Nous consolons en leur offrant des montres
les vachères qu'il délaissa.
V
Tous ces quasars dans les fins fonds de la cervelle
Prêts à surgir en rugissant
Pour dévorer le peu de ciel qui nous incombe
Nous les avons créés en les nommant
Tout comme Dieu le cancer et la bombe
Alors que nous n'en sommes qu'à nous supposer.
VI
Quand la parole est hors d'eau
Qu'elle s'intitule Enfer
Purgatoire ou Paradis
Dante lui donne à brandir
Le même bouquet d'étoiles
Dont Scipion avait rêvé
Si l'on en croit Cicéron
Et le bien nommé Macrobe
Qu'en pouvons-nous dire nous
qu'elles éclairent encore
Sauf que nous les savons mortes
Mais que grâce à toi soleil
Qui fais dans l'import-export
Tels de leurs menus morceaux
Perdurent dans notre corps ?
VII
Nous rêverons jusqu'à la fin
D'un excellent du subjonctif
Qui courberait l'espace-temps
Jusqu'à ce qu'il morde sa queue
Alors les galaxies qui s'engouffrent
Dans le crématoire céleste
Lasses de s'entre-déchirer
Reflueraient vers nous comme
Des banquises d'aubépine
Et nous entendrions nos mères
Depuis si longtemps mortes
Nous appeler pour la soupe.
|
|
Jean Orizet : Hommes continuels
Chaque homme est une étoile où s'enflamme le fossile de l'univers. Nous sommes les enfants d'une lumière morte. Dieu créateur du monde est né d'un autre dieu, explosion de pur infini. S'il accepte de venir à nous, c'est par des chemins buissonniers où l'espace et le temps se font des politesses. Notre vie est ombre ou étincelle, capable quelquefois d'avaler un trou noir.
Prédateur de l'instant zéro, j'emporte en mon repaire des mécaniques célestes encore balbutiantes pour mieux surveiller un monde en fusion où la vie voit la mort par transparence, où les astres se noient dès qu'un soleil a peur. Pillard de tous les possibles, je rôde en ma caverne encombrée de trésors ignorés des répertoires. Ma richesse vaut son pesant d'ombre, mon futur son comptant d'oubli.
Astres nés entre chien et loup, corps opaques, lunes de carton partagent l'incertain du monde avec des étoiles d'oubli où Persée continue d'aimer sa nébuleuse Andromède. Et le sang noir de Méduse d'où Pégase avait jailli arrose un ciel balafré de télescopes qui voyagent. Astres que nous interrogions pour connaître nos origines, vos ellipses ou révolutions renvoient intacte la question.
|
|
Jean Tardieu : Le ciel ou l'irréalité
(Trois esquisses)
1
Le soir vient... Attendons !... Quelle splendeur -- ou quel désastre -- quelle révélation peu à peu se prépare ?... Quel danger nous menace ?... Quelle angoisse encore sans figure et sans nom ?...
Peu à peu...
Peu à peu notre nuit terrestre se dilue dans la vaste nuit qui la contient : elles vont se confondre !
Ce bleu, cette couleur de l'invisible, où notre souffle prend naissance, où les yeux des vivants respirent, ce bleu, devenu maintenant presque noir, le voici transparent à l'obscurité tutélaire qui le dépasse et qui le perd dans ses abîmes et le mélange à ses trésors.
Millions de lumières mourantes ! Millions d'équilibres en fuite ! Millions de siècles en fusion ! Métaux enivrés par leur propre perte ! Monstres de pesanteur que la distance métamorphose en poussière ! Enfers aériens que la distance mue en bénédictions ! Tonnerres perpétuels, cratères de l'impitoyable clarté, bouillonnement du supplice des choses, usines de la mort que la distance change en un délicieux secret ! Mes yeux n'atteignent de réel que vos légers signaux dans la joie de l'été. Mais ce qui vous sépare, ce qui vous emporte et vous dévore, ce qui vous passe infiniment et, toujours plus vaste que vous, abandonne au loin votre chute -- ce qui se tait au-delà de tout, est-ce donc simplement ce que je nomme Espace ?... Espace ! Une idée ! Un mot ! Un souffle ! Est-il possible qu'une idée existe hors de la voix qui profère son nom ? Dérision ! Cette immensité n'est-elle qu'un mot ?...
Ce qui est vrai, c'est que je vois sans voir, dans ces ténèbres lamées d'or dont je suis aveugle et qui pourtant me dispensent un regard cent mille fois plus étendu que pendant le jour ! Sans fin ma pensée et ma vue prennent la place l'une de l'autre: je vois des constellations et je médite ce qui les sépare.
Est-ce donc une chose ou rien ? Ce champ, scintillant et sombre, de conjectures toutes possibles ou impossibles, instantanément détruites, tout me convainc que l'espace qui dévore ce monde, dès qu'il franchit les bornes du visible, se dérobe dans l'irréel. Du sol de ce jardin au sommet du ciel nocturne, le long de ce parcours énorme en un seul instant accompli, mon regard a passé de ce qui existe sûrement, à ce qui peut-être n'existe plus, ou pas encore.
Comme des rayons issus d'une puissante source, la réalité de notre monde s'affaiblit et se perd à mesure qu'elle s'éloigne de nous. Ma main qui soulève un marteau tient le réel, mais mon regard, élevé jusqu'aux lieux les plus hauts de la nuit, n'atteint que des Idées, des Fantômes, un fuyant déferlement de songes qui va mourir au bord de ce qui n'est pas.
2
Pour qui va dans le jour, les yeux fixés sur les murailles de sa vie, tout est confusion et lourdeur.
Mais, la nuit, hors du toit et des cloisons, quand s'annonce le Spectacle, quand les rampes du ciel s'allument, -- alors, rideaux de nos paupières, levez-vous sur cette scène illustre où l'Espace et le Temps, cherchant à s'engloutir l'un l'autre, jouent leur drame cruel sous le manteau de la sérénité !
Ici, près de nous, sont les objets de ce pauvre ménage et tout ce que le pas des hommes a mesuré sur sa misère. Mais, plus loin, le théâtre grandit, bourdonnant de silence, plus loin les masses ne sont plus que lignes, plus loin encore, pulsations de points d'or, caresses de l'obscurité, velours de l'éternelle absence.
Plus haut encore, je crois ou ne crois plus : parti de ces joyaux perdus qui enchantent mon regard et le lancent au-delà de lui-même, j'ai cessé de savoir ce que je vois : c'est mon esprit qui désormais poursuit le chemin commencé et, plus haut que mes yeux, considère.
Cependant que mon corps, tiré vers l'horizon, marche au-devant d'une absurde rencontre, mon geste accompli sans effort me prouve que tout ne résistera pas à jamais. Ô transparence de l'éther, spacieuse torture, palais dépeuplés et sonores, avenir dès longtemps révolu, douceurs d'un permanent désastre ! Ce que je n'atteins pas d'un coup d'oeil clair prend le masque de l'Impossible et la couronne du Néant. J'ai pitié de ce monde : pourtant je ne sais pas élever de rempart ni déployer de sortilèges pour défendre cet arbre supplicié, que je touche et qui est, contre cette invulnérable étendue qui n'est peut-être pas. Élevant mon regard, je passe, en une seconde, de ce qui vit à ce qui fut, ou qui jamais ne fut et jamais ne sera.
Redescendus, mes yeux éblouis ont arraché au monde ces feux volés aux dieux de l'irréalité. Leurs flammes entourent chaque objet proche et le menacent. Le ciel en même temps que moi roule sur les pentes infinies, comme autrefois les anges.
Une vaste et pâle idée intemporelle s'allie aux dures splendeurs de la terre. L'élément qui les baigne sans fin se porte en secret dans les angles et me guette.
L'attente est partout répandue sur les champs.
Une stupeur affreuse referme sur elles-mêmes, le soir venu, les fleurs.
3
Ô continuité hors d'atteinte, je te conçois, je te révère, mais je reste dans mes chaînes, car si je passais dans le camp de tes soldats, je perdrais le pouvoir de te nommer.
J'aime donc mieux disparaître et savoir. Je gagne un abri peu sûr mais familier, cabane glacée par la nocturne altitude, et j'attends que tu m'emportes.
Là-haut j'énumère ces points que je vois qui scintillent, plus loin ceux que je distingue à peine, enfin je songe à tout cela que je ne puis apercevoir, jusqu'à l'heure où, plongé tout entier dans le sommeil des éléments, je rejoins à la nage cette obscurité radieuse où toutes choses -- avec l'esprit qui les mesure -- se trouvent enfin révolues.
Alors me soulève de son vol égal et calme la faculté de Mémoire qui m'apprend à me souvenir de l'instant même et me montre à nos pieds dans cette basse plaine côte à côte à jamais ce que je pleure et ce que je sais.
Sur ce promontoire de cristal transpercé d'évidences, au bruit de poulies parfaites, vivre, mourir et connaître ne font qu'un. Une certitude ailée me délivre de ma lourdeur et, sans arme, sans crainte, comme sans limite et sans figure, ayant mon souffle pour toute puissance, mon regard pour toute parole, mon désespoir pour talisman, je monte au-devant de ce silence où je retrouve ma patrie.
|
|
|

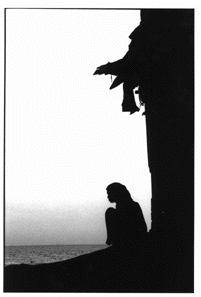 L'un des thèmes les plus puissants de la poésie est celui qui traite de la relation entre l'homme et le cosmos. " On se penche jusqu'à tomber sur l'astro- et la microphysique, mais qui aidera l'homme à vivre debout, à garder sa station verticale entre ces deux extrêmes ? ". Cette formule de Daniel Pons1 résume au mieux l'interrogation -- millénaire car fondamentale -- sur la place de l'homme dans l'univers.
L'un des thèmes les plus puissants de la poésie est celui qui traite de la relation entre l'homme et le cosmos. " On se penche jusqu'à tomber sur l'astro- et la microphysique, mais qui aidera l'homme à vivre debout, à garder sa station verticale entre ces deux extrêmes ? ". Cette formule de Daniel Pons1 résume au mieux l'interrogation -- millénaire car fondamentale -- sur la place de l'homme dans l'univers.